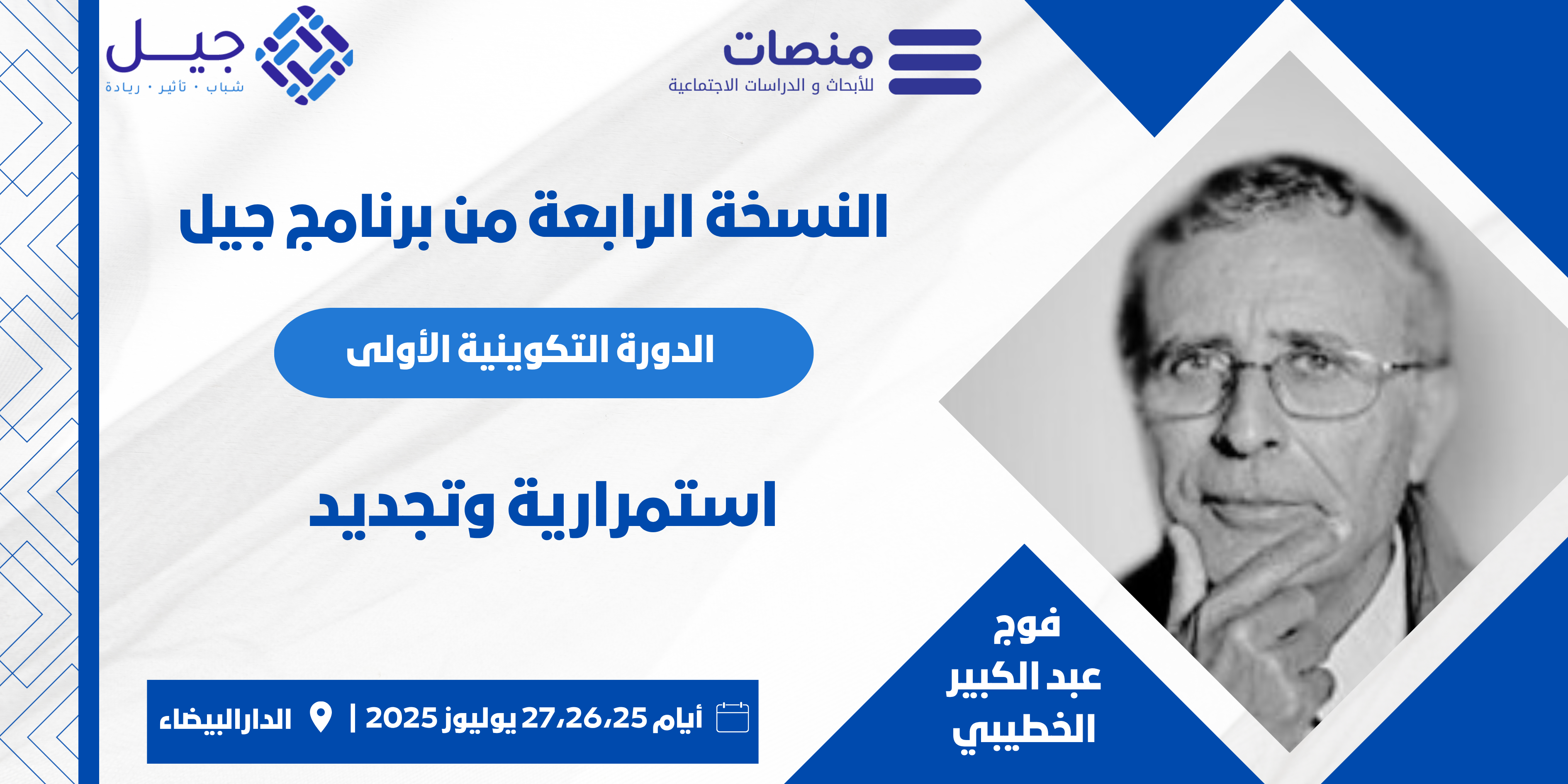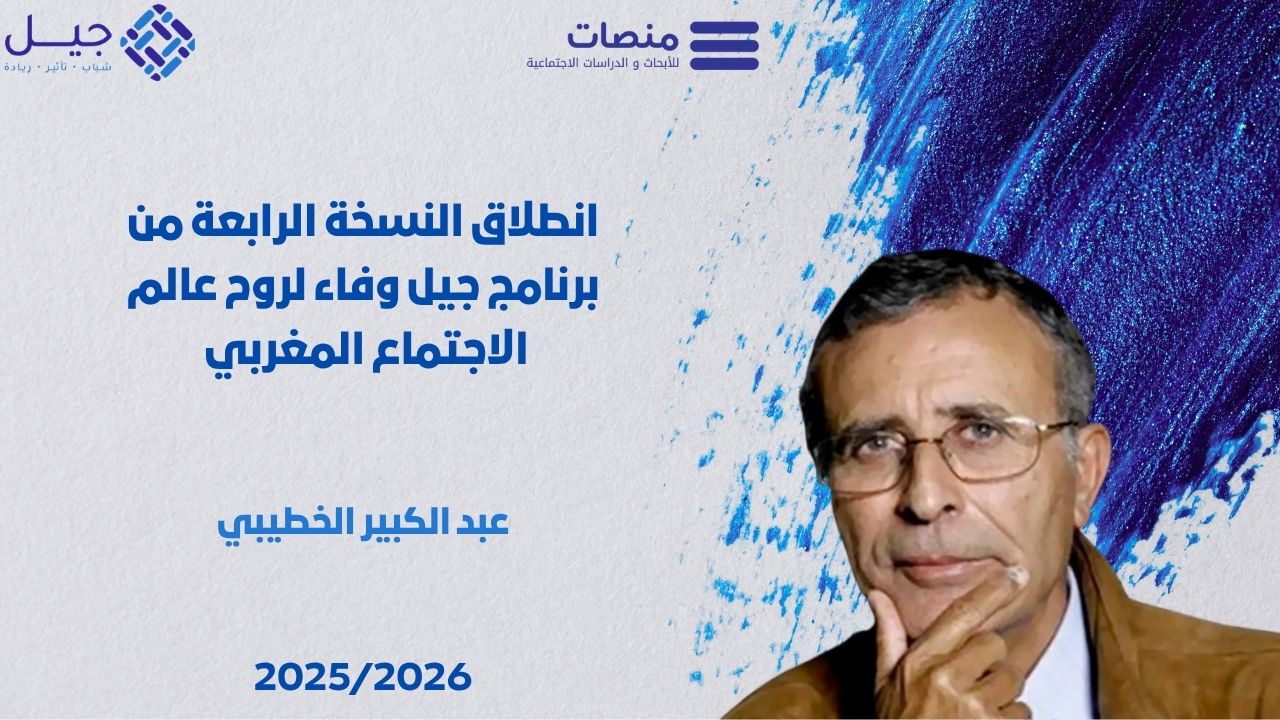Dans le cadre de ses efforts conjugués pour soutenir, développer les mécanismes de recherche
scientifique au Maroc, et articuler les modalités d'échange d'expériences avec
les centres de recherche en sciences sociales, le Centre Menassat pour les
Recherche et les Etudes Sociales a organisé le 17 mai courant, la troisième
rencontre interactive avec les centres
de recherche marocains.
Ce forum, organisé à l'hôtel Campanile Casablanca, sous l’intitulé
de : « La Société Civile Scientifique au Maroc : Identité, Organisation et
Perspectives » a connu la présence effective du professeur Mustafa El Mnasfi,
chercheur associé au Centre Jack Berques et à l'Institut Des Etudes sur le
Monde Arabe et Islamique, Madame Rokaya Ashmal, membre du bureau exécutif de
l'Observatoire Marocain de la Participation Politique. Etaient également
présents, Abderrahman Zakriti, représentant le Centre Hart, Madame Najat Nerci,
membre du Centre Marocain Des Etudes et de Recherche sur le Genre, le
professeur Abdelhadi Al-Halhouli, directeur du Centre Atlas de Recherche et
d'Etudes Sociales et responsable du Département de Sociologie à la Faculté des
Arts et des Sciences Humaines à Beni Mellal. Le Forum a aussi connu la présence
de Madame Souad Ettaoussi, directrice générale de la Fondation Taher Sabti et
experte des questions de l’Enfance et
des Femme Au Maroc, le professeur Aziz Mechouat, directeur de Menassat. A également
pris part à cette rencontre interactive, par voie virtuelle le professeur
Saadeddine Igamane, directeur de l'Institut Interdisciplinaire des Sciences
Sociales de Fès.
Cette rencontre a été modérée par Aali Outcharraft, lauréat du programme JIL, en présence de nombreux professeurs, chercheurs et acteurs de la société civile, ainsi que plusieurs personnalités intéressées par la question des centres de recherche.
Aziz Mechouat : Localiser la science
et les connaissances est une étape essentielle dans le développement des
centres de recherche.
Lors de son mot d’ouverture du Forum, Aziz Mechouat a mis l’accent sur les centres
de recherche au Maroc en tant qu'élément important sur la scène scientifique,
et un vecteur de développement pour une société rationnelle qui valorise la
science et la connaissance, et ce malgré les obstacles et les défis auxquels
ces centres sont confrontés et qui les empêchent de s'imposer en tant qu’
acteur scientifique capable d'influencer les orientations de la recherche et les
prises de décision. En parlant de ces défis, Mechouat explique qu'ils sont principalement liés à
des problèmes organisationnels, dont le manque de financement, le manque de
durabilité, la faible productivité, le manque de gouvernance interne et l'instabilité
des ressources humaines, en plus des entraves liées à d'identité législative et
juridique.
L'orateur ajoute que pour renforcer leur rôle dans la production de connaissances scientifiques et surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés, ces centres doivent s'efforcer de bâtir les passerelles entre les universitaires, les décideurs, la société civile, les partis politiques et l'opinion publique. Nonobstant d’un travail intégré avec les universités, et des efforts conjugués pour mener des recherches puisées de la rigueur scientifique, de manière à ce qu’elles deviennent la matière et le terrain propice au débat public. En guise de conclusion, Aziz Mechouat a mis l’accent sur la nécessité d'institutionnaliser ces centres sans oublier de les doter d'une identité législative et d'un cadre juridique qui contribuerait à la compréhension de l'environnement externe et interne dans lequel ils opèrent, ce qui constituera une base de développement, des alternatives et des stratégies qu’ils développent.
Rokaya Ashmal : L'identité des
centres de recherche scientifique au Maroc : caractéristiques, structure
organisationnelle et amélioration des performances.
Dans la même continuité,
Rokaya Ashmal a pointé du doigt le manque important d'études officielles
sur les institutions de recherche au Maroc. Elle a également souligné le
changement dont ces institutions ont été
témoins après la création de l'Initiative Nationale pour le Développement
Humain en 2003 et après la Constitution de 2011. Elle a ajouté que les
institutions de recherche implémentées au cœur des universités sont souvent
établies comme des pépinières pour
soutenir des groupes de recherche, et garantir par cela leur forme juridique.
En ce qui est de leur fonctions, l'oratrice poursuit que ces institutions sont utilisées comme groupes de réflexion pour la production des connaissances scientifiques, et comme outils de plaidoyer et de pression pour parvenir à des changements sociétaux. Achmal ajoute que ces recherches dépendent souvent du financement et des ressources humaines disponibles, ce qui explique l'écart entre le rythme de la production scientifique et la qualité des activités de ces institutions. Pour conclure, l'intervenante, a mis en relief le rôle du plaidoyer et de la négociation, principalement liés aux questions législatives et réglementaires, et de la coordination et du réseautage, qui visent à renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre les différentes institutions scientifiques. Mais aussi le rôle prépondérant de la communication, et l'ouverture sur les réseaux sociaux et les plateformes électroniques pour améliorer le positionnement de ces centres à l’échelle mondiale.
Mustafa El Mnasfi : La société
civile scientifique au Maroc entre production de connaissances et gestion de
projets de développement.
Pour sa part, El Mnasfi a abordé les défis et les perspectives
auxquels sont confrontés les centres de recherche de la région
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Il a souligné que le déclin du
rôle des universités dans la production de connaissances académiques, a fourni
un alibi pour les centres de recherche afin de
répondre à des besoins que les États ne peuvent pas satisfaire, surtout
en termes de recherche scientifique.
Dans ce sens, El Mnasfi s’interroge sur le degré d'indépendance de ces
institutions, notamment à la lumière des tendances et des politiques imposées
par les bailleurs de fonds internationaux. A ce niveau, il souligne que le
financement international approuvé par les centres de recherche crée une sorte
de défi qui transforme le rôle de ces centres de production de connaissances
vers la gestion de projets de développement.
Pour conclure, El Mnasfi a mis le point sur la nécessité d’ériger une double structure institutionnelle comprenant deux pôles, le premier chargé de la gestion des projets et le second de la recherche, afin qu'ils travaillent unanimement pour équilibrer et harmoniser la production des connaissances et la gestion de projets de développement, notamment, en se finançant mutuellement.
Abderrahman Zakriti : Création du
centre Hart : Défis et perspectives de développement
En partant de son expérience au Centre Hart, Zakriti affirme que l'idée de la création de cet organisme avait comme
point de départ un projet commun qui cherche à s'affranchir de la bureaucratie
universitaire et à s'ouvrir concrètement sur l'environnement socio-économique.
L’objectif étant, de fournir des connaissances scientifiques sociologiques
susceptibles de suivre le rythme des évolutions dans ce domaine pour contribuer
au développement local, en mettant en coalition
les efforts avec l'université en tant que partenaire social, politique
et économique de la région.
Selon Zakriti, la création du centre a été confrontée à plusieurs
défis, principalement liés à la définition de son identité, de ses objectifs et
de sa mission, d'autant plus que le centre était le résultat d'un travail
bénévole, ce qui constitue une arme à
double tranchant à la fois, en raison de sa capacité à contrôler le niveau de
participation et d’engagement en fonction du temps et des efforts disponibles.
Abderrahmane Zakriti a souligné l’adhésion du Centre Hart aux valeurs de
développement scientifiques et son
ouverture aux différents partenaires malgré leurs identités différentes, en concentrant
son attention sur des sujets qui incluent notamment les questions de jeunesse
et d’immigration.
Malgré la lenteur de sa croissance, selon l'intervenant, le centre HART bénéficie d'expériences mondiales et locales probantes qui confortent son adhésion scientifique et son implication efficace dans le développement. Et pour finir, Zakriti a souligné, qu'outre le défi financier et logistique, le Centre Hart est certes confronté à des obstacles dans le montage des projets, quoique ces défis ne l’ont pas empêché d'organiser des séminaires annuels dans le but de renforcer le réseau de ses partenariats et atteindre ses objectifs de développement.
Souad Ettaoussi : Les moyens de
renforcer le partenariat entre les organisations de la société civile et les
centres de recherche.
Toujours en liaison avec ce qui précède, Souad
Ettaoussi a souligné l'importance de la coopération entre les centres de
recherche et les associations de la société civile, comme étant un point
essentiel pour parvenir à une compréhension globale des questions sociales.
Elle estime que les associations de la société civile ne peuvent pas réussir
sur le terrain, et cette réussite ne
peut être garantie que par un
encadrement scientifique des centres de recherche qui offrent les bases
scientifiques du plaidoyer.
L’intervenante a souligné la nécessité d'un équilibre entre les
objectifs et les visions des associations de la société civile et des centres
de recherche pour parvenir à une coopération fructueuse. Elle a également
soulevé la question des défis auxquels est confrontée cette coopération, tels
que le manque de financement, l'incompatibilité des agendas des deux
partis, et l’insuffisance des ressources
humaines. De surcroît, Ettaoussi a insisté sur l’importance de garantir la
qualité des données collectées par les chercheurs, ce qui pourrait inciter à
une adhésion des décideurs aux processus de développement des centres.
Avant de conclure son intervention, la directrice de la Fondation Taher Al-Sabti a proposé quelques moyens pour surmonter les défis auxquels sont confrontés les centres de recherche, dont essentiellement : la nécessité de renforcer la communication et la compréhension pour définir les besoins et les défis mutuels entre les associations et les centres de recherche. Enfin, l’adoption d’une approche participative entre les deux parties pour renforcer leur influence sur les politiques publiques ainsi que sur les décideurs.
Najat Nerci : Les centres de
recherche et leur rôle dans la transformation de l'expérience en connaissances
Tout en partant de son expérience dans la création du Centre de recherche les Femmes et le Genre, Najat Nerci affirme que cette aventure a commencé par la création d’un programme de maîtrise intitulé « Genre, Discours et Représentations ». Ces ateliers visaient à diffuser les connaissances et à permettre aux étudiants de les produire, compte tenu de la rareté des ressources et du caractère bureaucratique des laboratoires et centres de recherche des universités. Dans le même sens, l’oratrice a confirmé que le centre a été créé dans le but de soutenir la recherche académique pour tenter de rapprocher les différents domaines des sciences humaines. L’enjeu était aussi, de diffuser les connaissances sur le genre et de tenter de changer la vision dominante sur la hiérarchie entre les sexes, surtout à l’aune d’une société qui connaît une sorte de flux et reflux entre projets conservateurs et projets progressistes, sous le contrôle du religieux et un discours qui s’appuie sur cette hiérarchie. Nerci a également évoqué l’importance des publications scientifiques qui visent à diffuser la culture de production des concepts puisés de la réalité marocaine en transformant l'expérience en savoir. Au bout de son intervention, Nerci a souligné la nécessité de produire des connaissances issues de la réalité marocaine, car ces connaissances contribuent à la réussite d'un projet sociétal plus égalitaire.
Abdelhadi El-Halhouli : Les centres
de recherche scientifique et leur rôle dans la promotion de la recherche
scientifique.
À travers son intervention, Abdelhadi El-Halhouli a exposé le rôle
de son expérience universitaire et de recherche dans la création du Centre
Atlas d'études et de recherche sociales, soulignant l'importance de ce centre
dans la promotion de la recherche scientifique et dans le traitement des
questions sociétales telles que le genre, l’enfance, l’identité, etc… . De
surcroît, son importance à fournir des
connaissances scientifiques qui peuvent être utilisées pour réaliser un
changement positif. El-Halhouli a notamment souligné la nécessité d'une
coopération entre le tissu collectif et les centres de recherche scientifique
pour transformer les connaissances brutes en connaissances scientifiques
organisées. Dans le même contexte, il a abordé la question de la liberté et de
l'indépendance de ces centres à mener leurs recherches loin des idéologies antérieures.
Il a également souligné la nécessité d'être conscient des
événements inattendus qui pourraient résulter des activités de ces centres, ce
qui, selon l'orateur, nécessite d'abord une prudence et une transparence dans
l'utilisation des statistiques et des données empiriques. Il s’agit aussi,
selon le même orateur, de renforcer les
capacités de ces centres en termes de gestion de projets et réseautage, à
l’échelle nationale et internationale.
En guise de conclusion, El-Halhouli a suggéré d'adopter le terme de « groupes de réflexion » au lieu de celui de « société civile scientifique », soulignant l'existence de décrets réglementant le travail de ces centres au lieu de modifier les lois existantes.
Saadeddine Igamane : Les Centres de
recherche : vers de nouveaux horizons et une coopération institutionnelle
efficace
A travers une intervention virtuelle, Saadeddine Igamane à la tête
de l'Institut interdisciplinaire des sciences sociales a souligné que les centres de recherche
privés souffrent d'une crise d'identité, car la forme d'associations qu'ils
prennent actuellement n'est pas du tout appropriée et crée plusieurs
complications juridiques, administratives et fiscales.
Pour surmonter ces complications bureaucratiques, Igamane estime
qu'il est nécessaire d'établir un nouveau cadre juridique qui reconnaisse les
centres de recherche en tant qu’entreprises sociales et leur permette de
fonctionner de manière plus flexible. Cette flexibilité, qui s'impose comme une
caractéristique positive, aide à prendre des décisions et à s'adapter aux
changements, à la lumière des déficiences en termes de manque de
professionnalisme et de la difficulté de planifier stratégiquement et d'obtenir
des ressources financières et humaines.
Par conséquent, selon Igamane, il faut employer des personnes
qualifiées pour accomplir les tâches nécessaires au lieu de compter uniquement
sur le travail bénévole. En termes de perspectives, il estime qu'il existe des
possibilités de développement prometteuses grâce à la mise en réseau des centres
de recherche, des laboratoires, du secteur privé et des universités. La
coopération avec les universités et les institutions peut améliorer la
recherche scientifique et le développement technologique, mais elle offre
également l'opportunité d’échanger des connaissances et des expériences.
Au terme de sa présentation virtuelle, Igamane a souligné la
nécessité de fournir un environnement approprié pour que les travaux de
recherche et la coopération institutionnelle réussissent, outre l'importance
d'encourager les chercheurs à créer des clusters et des associations, estimant
que cette question peut constituer une incitation à améliorer la qualité de la
recherche scientifique et renforcer l’innovation et la découverte scientifique.
Il est à rappeler que le Forum a été initié par le centre Menassat
pour les recherches et les études sociales. Ce centre est une institution de
recherche et une organisation à but non lucratif qui offre un espace
scientifique propice à la
recherche, pour réaliser des
études empiriques sur le terrain et stimuler les débats publics. Le centre
cherche à ériger des ponts de communication entre l'acteur académique et
l'acteur civil, et vise à développer la recherche sociologique et à mener des
recherches approfondies sur le terrain visant à développer des idées pionnières
et à appliquer différentes approches scientifiques innovantes aux problèmes
sociaux aux niveaux local, national et régional. , et les présenter aux
décideurs toutes catégories confondues, aux universitaires, et aux représentants de la communauté civile
et à toutes les personnes intéressées.